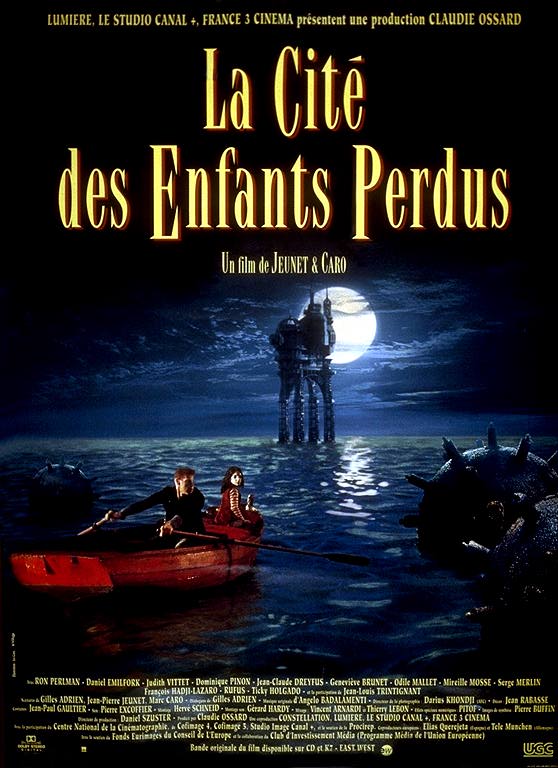JURASSIC PARK
 Adoré par certains, décrié par d'autres, Steven Spielberg a pourtant mis tout le monde d'accord avec au moins un film, Jurassic Park. Adapté d'un roman de Michael Crichton (qui s'est forgé depuis une solide réputation de "casseur de films"), le scénario est un bijou, en faisant le must du film catastrophe. Premier avantage : la durée. 1h55 montre en main, c'est juste ce qu'il faut pour ne provoquer ni frustration ni ennui. Néanmoins, Spielberg prend son temps pour nous faire découvrir le fameux parc jurassique, et il faut quasiment trois quarts d'heure pour commencer à entrer dans la vraie aventure, celle qui fait flipper. Trois quarts d'heure passionnants qui rendent crédible la renaissance de ces grosses bébètes à écailles. Quand éducatif et moraliste ne riment pas, c'est rare et appréciable.
Adoré par certains, décrié par d'autres, Steven Spielberg a pourtant mis tout le monde d'accord avec au moins un film, Jurassic Park. Adapté d'un roman de Michael Crichton (qui s'est forgé depuis une solide réputation de "casseur de films"), le scénario est un bijou, en faisant le must du film catastrophe. Premier avantage : la durée. 1h55 montre en main, c'est juste ce qu'il faut pour ne provoquer ni frustration ni ennui. Néanmoins, Spielberg prend son temps pour nous faire découvrir le fameux parc jurassique, et il faut quasiment trois quarts d'heure pour commencer à entrer dans la vraie aventure, celle qui fait flipper. Trois quarts d'heure passionnants qui rendent crédible la renaissance de ces grosses bébètes à écailles. Quand éducatif et moraliste ne riment pas, c'est rare et appréciable.Puis vient le temps des gros dinos méchants. Et là, Spielberg fait preuve de maestria dans l'enchainement dramatique des situations, et sa caméra mouvante n'a jamais été aussi efficace. Résultat : un film qui ne fout pas vraiment la trouille, mais qui est tout de même très impressionnant. Treize ans après, les effets spéciaux sont toujours aussi crédibles (là où le récent King Kong sentait un peu trop l'animatronic).
Un regret cependant : on devine très facilement qui mourra et qui mourra pas. Pas d'exception à la règle : les personnages secondaires y passent, et les principaux survivent. C'est d'autant plus dommage que le bouquin de Crichton était autrement plus méchant avec ses héros. On n'aurait vraiment rien eu contre la mort cruelle d'un des deux mioches (un peu agaçants, mais c'est leur rôle qui l'exige).
Greffant à son film catastrophe une réflexion pas con sur les merveilles et les risques de la création Spielberg réussit son pari, celui de faire un grand divertissement, populaire, exigeant et intelligent. c'est assez rare pour être souligné. Le meilleur film du monsieur.
8/10