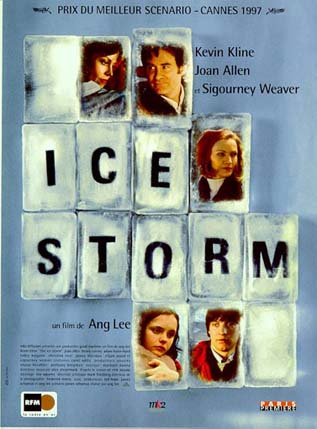CONVERSATION SECRÈTE
 Harry Caul dirige une petite société d'écoute. Travailleur scrupuleux et intègre, il est chargé de surveiller les faits, gestes et propos d'un couple possiblement adultérin. Mais bientôt, Harry Caul a des doutes : et s'il était en train de participer à une opération plus grosse que lui?
Harry Caul dirige une petite société d'écoute. Travailleur scrupuleux et intègre, il est chargé de surveiller les faits, gestes et propos d'un couple possiblement adultérin. Mais bientôt, Harry Caul a des doutes : et s'il était en train de participer à une opération plus grosse que lui? Avec un pitch pareil, on pourrait s'attendre à ce que Conversation secrète ne soit qu'un énième film d'espionnage avec manipulations à la clé. S'il fait évidemment partie de cette catégorie, c'est surtout par sa description de la paranoia de son héros que le film de Francis Ford Coppola se distingue. Harry Caul est un homme seul et solitaire, qui ne s'implique jamais dans ce qu'il écoute, et refuse de dire le moindre mot à propos de son travail. Femme, amis, collègues : tous vont le fuir un à un, rebutés par tant de silence. Harry Caul est un mur, une machine de précision qui ne peut supporter qu'un de ses rouages soit mal graissé.
Plus que l'excellent thriller qu'il est aussi, Conversation secrète est donc d'abord le portrait saisissant et mélancolique d'un homme qui a tout donné à son travail. Dans le rôle principal, Gene Hackman est tout simplement ahurissant, sa froideur naturelle se mêlant à un sentiment d'inquiétude permanent. Quant à Francis Coppola, qui tourna ce film entre les deux premiers épisodes du Parrain, il révèle une nouvelle facette de son talent de réalisateur-caméléon. Impossible de reconnaître le style du réalisateuyr d'Apocalypse now ou du Parrain. La mise en scène de Conversation secrète est sobre, glacée, clinique, pour mieux épouser la personnalité du personnage principal. Injustement méconnu dans la filmographie de Coppola, Conversation secrète mérite d'être considéré comme le meilleur film de son auteur.
9/10