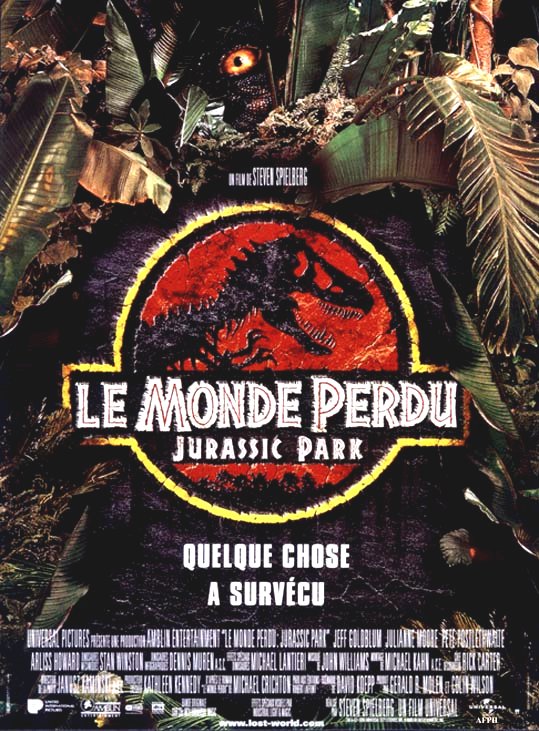LA SENTINELLE
 Étudiant en médecine légale, Mathias Barillet trouve une tête momifiée dans sa valise. Objet étrange et fascinant qui va le pousser dans ses retranchements les plus intimes. Ou comment un jeune cinéaste nommé Arnaud Desplechin débarque dans le cinéma français et colle une grande baffe à tout le monde.
Étudiant en médecine légale, Mathias Barillet trouve une tête momifiée dans sa valise. Objet étrange et fascinant qui va le pousser dans ses retranchements les plus intimes. Ou comment un jeune cinéaste nommé Arnaud Desplechin débarque dans le cinéma français et colle une grande baffe à tout le monde.Plus encore que la timorée Vie des morts, La sentinelle marque la naissance d'un style unique et reconnaissable entre mille. Le cinéma de Desplechin, fait d'angoisses personnelles, de grandes questions métaphysiques et de discussions mondaines, est un univers fascinant parce que complètement neuf. Qu'importe le point de départ du scénario (ici, un postulat digne d'un film d'espionnage ; là, une pure base de drame...) : le cinéma de Desplechin importe moins par ce qu'il raconte que par ce qu'il dit vraiment. La fascination de Mathias pour cette tête repoussante, son obstination à en découvrir l'origine, tout cela n'est que la métaphore à peine voilée de la vie d'un jeune homme qui court après lui-même. Employant un casting riche et foisonnant (Salinger, Devos, Denicourt, Amalric, Desplechin frère...), Arnaud Desplechin livre un film plein, à la fois joyeusement bavard et extrêmement angoissant, où Freud cotoie Corneille et où les thèmes les plus lourds peuvent devenir légers comme des plumes. C'est ce qu'on appelle du grand cinéma.
9/10