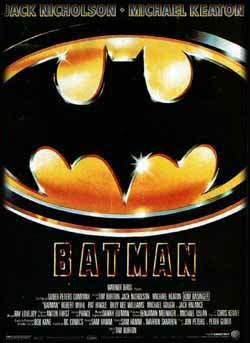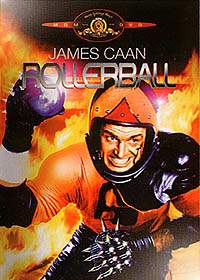UN HOMME UN VRAI
 Un documentaire d'entreprise. Une comédie musicale. Un drame sociologique. Une comédie romantique. Un docu animalier. Un homme un vrai, c'est un peu tout ça à la fois, mais c'est surtout beaucoup plus. Car Jean-Marie & Arnaud Larrieu mettent le doigt dans des territoires encore vierges, loin des sentiers battus. Trois actes. Boris rencontre Marilyne lors d'une réunion d'entreprise. Cinq ans plus tard, mariés, deux enfants, leur couple bat de l'aile et implose lorsque Marilyne se lance dans une aventure lesbienne à Ibiza. Et cinq ans encore après, alors que Boris est devenu un guide de haute montagne réputé, ils se retrouvent par hasard pour découvrir l'incroyable mystère des coqs de bruyère...
Un documentaire d'entreprise. Une comédie musicale. Un drame sociologique. Une comédie romantique. Un docu animalier. Un homme un vrai, c'est un peu tout ça à la fois, mais c'est surtout beaucoup plus. Car Jean-Marie & Arnaud Larrieu mettent le doigt dans des territoires encore vierges, loin des sentiers battus. Trois actes. Boris rencontre Marilyne lors d'une réunion d'entreprise. Cinq ans plus tard, mariés, deux enfants, leur couple bat de l'aile et implose lorsque Marilyne se lance dans une aventure lesbienne à Ibiza. Et cinq ans encore après, alors que Boris est devenu un guide de haute montagne réputé, ils se retrouvent par hasard pour découvrir l'incroyable mystère des coqs de bruyère...Il n'y a pas vraiment de mots pour décrire ce qui se passe à l'écran pendant deux heures. Le burlesque cotoie la gravité la plus dense, on navigue perpétuellement entre la gène la plus totale et un plaisir extatique. L'histoire de Marilyne et Boris est à la fois la love story la plus touchante du monde et un conte cruel qui émaille la peinture de nos existences sordides. Par le biais d'une écriture fantisiste et débridée, transcendée par le jeu décalé et somptueux de ses deux interprètes principaux (Amalric et Fillières, dont la génie n'apprtient qu'à eux), Un homme un vrai est le machin le plus ébouriffant qu'on ait vu depuis des lustres.